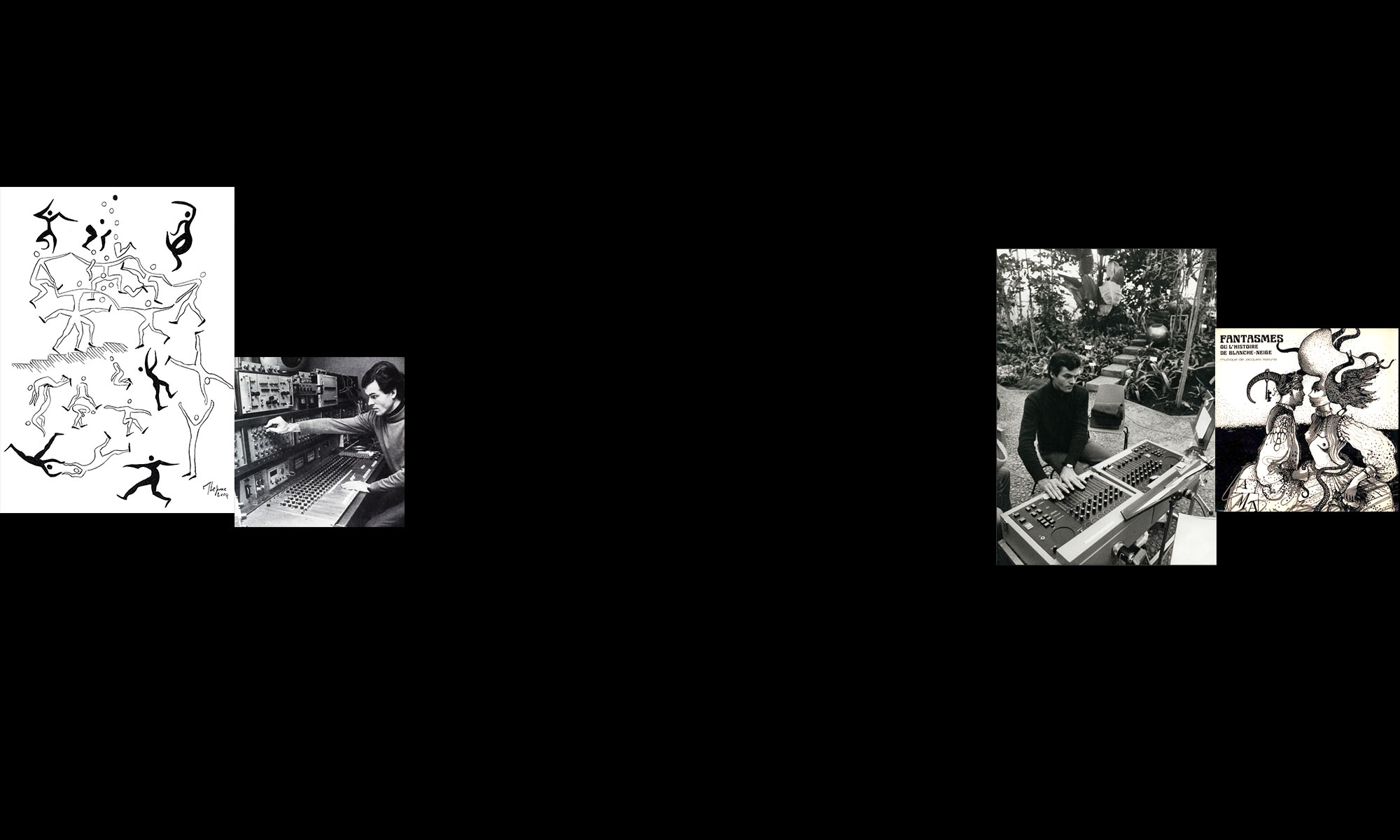2004 – 75’05
1.Entrée et sonneries d’appel, à ceux qui portent l’étendard de la musique concrè: 1’45
Les Presque impalpables, à M. F.M. et R. C. : 2’51
La Taupe, à D. K. et Bz. F. : 2’27
Lamentations du peuple escargotier, à X… : 3’10
Sérénade du rossignol, à D. D. : 3’23
La Parade du coq, à A. S. : 4’50
Refrain-miroir 1, à I. X. : 2’15
Le Carillon des anoures, à L. F. : 4’14
Facéties du moustique, à Ph. M. et J.M. D. : 2’25
Le Crocodile, à A.Y. : 2’45
En suivant le corbillard, à D. T., F. D. et Ch. Z. : 5’07
La Pendule à coucou , à M. C. et A. V. G. : 3’09
Refrain-miroir 2, à J. C. : 1’36
Altercation à la ferme, à F. B. et G. R. : 2’51
Voyageurs regardant les vaches, à B. P. et I. M. : 7’14
Ces oiseaux de l’océan…, à Y… : 2’23
Les Poules , à Z… : 4’05
La Folie de l’éléphant, à P. S. et P. H. : 2’58
Berceuse pour Basilide, Alice, Victor Merlin et les autres … :2’36
2.Pot–pourri ou refrain-miroir 3 et sonneries de fin, aux jeunes:11’1
Evidemment je ne peux éviter de comparer cette pièce au Carnaval des animaux de Saint-Saëns. Voici en effet à peu près le même univers et le même schéma proposé à un public universel et bon enfant. Mais ici le forme dépasse celle de le simple succession d’images.
J’ai initialement pris l’idée du titre pour modèle, alternant couplets et refrains, en martelant ainsi un temps linéaire et « d’horloge». Puis, rapidement, le projet évoluant et augmentant en durée, j’ai imaginé alors une forme plus souple en réduisant le nombre des refrains et en en faisant autre chose, des « refrains-miroirs », sortes de traces indéterminées dans la durée : d’une part, avec la redite de quelques fragments d’images provenant des 5 ou 6 séquences antérieures et d’autre part, avec des figures de batterie (moments de contraction ou d’exaltation rythmique constituant l’ossature de ces refrains-miroirs) qui pouvaient, quant à elles, apparaître de manière moins systématique et plus élargie au cours de séquences précédentes ou futures. Le dernier de ces refrains, servant de final, est en réalité un pot-pourri qui procède d’une manière encore différente, reprenant les moments les plus caractéristiques dans toute l’œuvre. Ainsi ces différents types de temps, ne fonctionnant pas à la même vitesse et glissant l’un sur l’autre, aboutissent à une notion élastique de la durée de la pièce. Peut-être l’idée m’a t-elle été suggérée par les souvenirs que me laissaient l’Orgie de brigands dans Harold en Italie avec ses retours en arrière sur les motifs de ses précédents mouvements ?
Cette pièce est comme une danse du monde avec un brin d’humour ou de tendresse pour certains animaux décriés et du sarcasme pour d’autres. C’est aussi, à l’occasion, une caricature de l’homme et un hommage rendu à l’enfance… Cette pièce, la plus longue que j’ai réalisée et sans doute la dernière aussi imagée et facétieuse, me permet d’en dédier les différentes séquences mais une dédicace comme celle-ci n’est pas chose facile ; elle est forcément imparfaite quand elle couvre la rencontre avec ceux qui ont vécu l’aventure musicale la plus forte de ces cinquante dernières années. Elle s’adresse à des gens d’écriture pour lesquels j’éprouve de l’admiration, à ceux que j’ai côtoyés au GRM ou d’autres, qui ont simplement croisé mon chemin et sont devenus des amis. Ceux qui feront le rapprochement entre eux, mes textes et ma musique n’ont pas à s’offenser ; pas plus que ceux qui ne sont pas cités dans cette liste ou ceux qui ne le sont pas individuellement : ce n’est pas malignité de ma part et je leur demanderai plutôt de sourire…